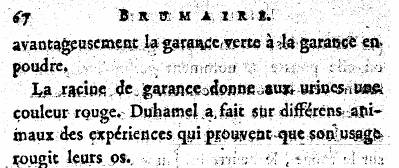Retour à la page "ça pousse chez nous"
La Garance
La "garance" de la
famille des rubiacées se rencontre souvent dans les terres en friche et
dans les taillis.
Plante herbeuse, vivace, dont la souche traçante, formée de rhizomes épais,
donne naissance à des tiges annuelles, couvertes de feuilles verticillées,
oblongues lancéolées, fortement denticulées épineuses sur les bords.
Les fleurs, d'un blanc jaunâtre, sont disposées en cymes composées, axillaires
et terminales.
Les fruits sont des baies noires, de la grosseur d'un pois.
La matière colorante rouge appelée "alizarine" se trouve dans les racines.
La floraison a lieu de mai à juillet.
Quelques éléments sur la longue histoire de la garance
Une des premières
utilisations par l'homme a été identifié dans les grottes décorées de Lascaux,
vers 12 000 avant notre ère.
Des teintures
anciennes sont étudiés sur des textiles chinois datant de 3 000 avant notre ère.
Vers 2000 avant notre ère on utilisait la garance ou l'indigo, en Inde, en
Palestine ou en Egypte.
La garance donnera la couleur la plus solide et la plus connue des teintures
végétales, celle que l'on utilisa le plus longtemps. Elle fut dans le Roussillon
l'objet d'une culture intensive.
Les racines, une
fois récoltées, étaient séchées avec soin, puis broyées et pilées, afin d'en
séparer l'écorce et le bois inutile, la substance colorante étant localisée sous
l'écorce, dans l'aubier. C'est cette garance, plus ou moins finement pilée et
blutée, qu'on livrait au commerce. Un processus très raffiné, et qu'on ne
cessait d'améliorer, permettait aux teinturiers d'en composer les bains de
teinture nécessaires à leur industrie. La garance ne se fixait intimement à la
substance des fibres animales ou végétales des tissus qu'en présence de calcaire
et sous l'action d'un mordant, tel que l'alun.
Les procédés, bien
entendu, variaient selon qu'il s'agissait de soie, de laine, de coton, voire de
lin. La garance faisait partie, avec le kermès et la cochenille, des matières de
“grand teint” ou “bon teint”, par opposition à d'autres teintures, comme
l'orseille ou le brésil, réservées au “petit teint”.
La Garance a été cultivé dans la région de Perpignan et de Elne autour et avant
1323.
C’est à cette
époque qu’un litige est signalé autour d’une dîme due à l’évêque d’Elne sur la
culture de la garance dans la région de Perpignan. Il faut savoir également que
le travail du drap dans le Conflent et le Vallespir était largement répandu au
XIIe siècle avec une tradition et une réputation de haute qualité.
En 1350 une usine à
garance s’établit à Perpignan, près de la porte Saint Martin.
Jusqu’au XVIeme
siècle Elne sera le centre important du commerce de la garance.
Parmi les autres
centres de culture et de traitement de la garance il faut citer en 1449 et 1453
Pia, Claira, Saint Hippolyte, Villelongue de la Salanque et Saint Laurent.
A partir de 1449 la
culture se déplacera également vers Saint Feliu d’Amont et Millas.
Le marché de la
garance à Elne est encore signalé en 1515.
Les derniers
vestiges de la culture de garance se trouveront à Bompas.
Le 3 avril 1625, la
communauté ecclésiastique de Saint Jean de Perpignan permit à un exploitant de
produire à la grange de Canamals, au même prix de fermage que les terres à blé.
et la production de garance semble régresser à partir de cette époque.
Ce sont les progrès
de la chimie qui amenèrent, au XIXe siècle, la disparition de la
culture de la garance au plan national.
De nos jours la
garance poursuit sa vie sauvage.
Dans le calendrier républicain
"Garance" est le
nom assigné au tridi 23 Brumaire.
Avec le texte
suivant :
Retour à la page "ça pousse chez nous"
|


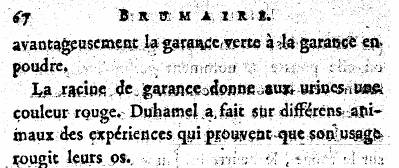
Retour à la page "ça pousse chez nous"
|
Brumaire tridi 23
Garance.
Plante de la famille des étoilées. A ses
fleurs jaunes succèdent des baies noirâtres qui contiennent la semence. On
en cultive plusieurs espèces, et cette plante utile est très répandue en
France. Nous étions autrefois obligés de la tirer de l’étranger ; elle vient
dans toute sorte de terre, mais elle périt quand elle est fubmergée. On la
multiplie ou de graines, ou par les racines, ou en la provignant. Les champs
où elle pousse se nomment garancières ; on la fauche vers le
commencement de Vendémiaire.
Les feuilles de garance plaisent aux vaches,
elles donnent à leur lait une teinte tirant un peu sur le rouge, le beurre
est jaune et de bon goût ; on se sert de ces feuilles pour nettoyer les
vaisseaux d’étain auxquels elles donnent le plus beau lustre.
C’est pour sa racine que l’on cultive cette
plante ; on la tire de terre vers la fin de Brumaire. Dès qu’elle est
arrachée, on la fait sécher sur le pré sans la laver pour ne rien entraîner
de la matière colorante ; souvent on se sert de l’étuve, ce qui diminue
beaucoup de son poids. Quand elle se rompt en pliant, on la juge assez
sèche, alors on la bat à coup de fléau pour la débarrasser du chevelu, de
l’épiderme et d’une portion de terre qui étoit restée, et on la réduit en
poudre.
La garance ainsi préparée, ou par des procédés
à peu près semblable, est un des meilleurs ingrédients pour la teinture en
laine. Le rouge qu’elle fournit est de bon teint ; elle procure de la
solidité aux autres couleurs. On s’en sert pour fixer celles déjà employées
sur la toile de coton. Cette opération s’appelle le Garançage.
D’après les essais du citoyen Dambournay, on
pourroit, dans les pays où on la cultive, substituer avantageusement la
garance verte à la garance en poudre.
La racine de garance donne aux urines une
couleur rouge. Duhamel a fait sur différens animaux des expériences qui
prouvent que son usage rougit leurs os.
 |
|

|
 |
Retour à la page "ça pousse chez nous"